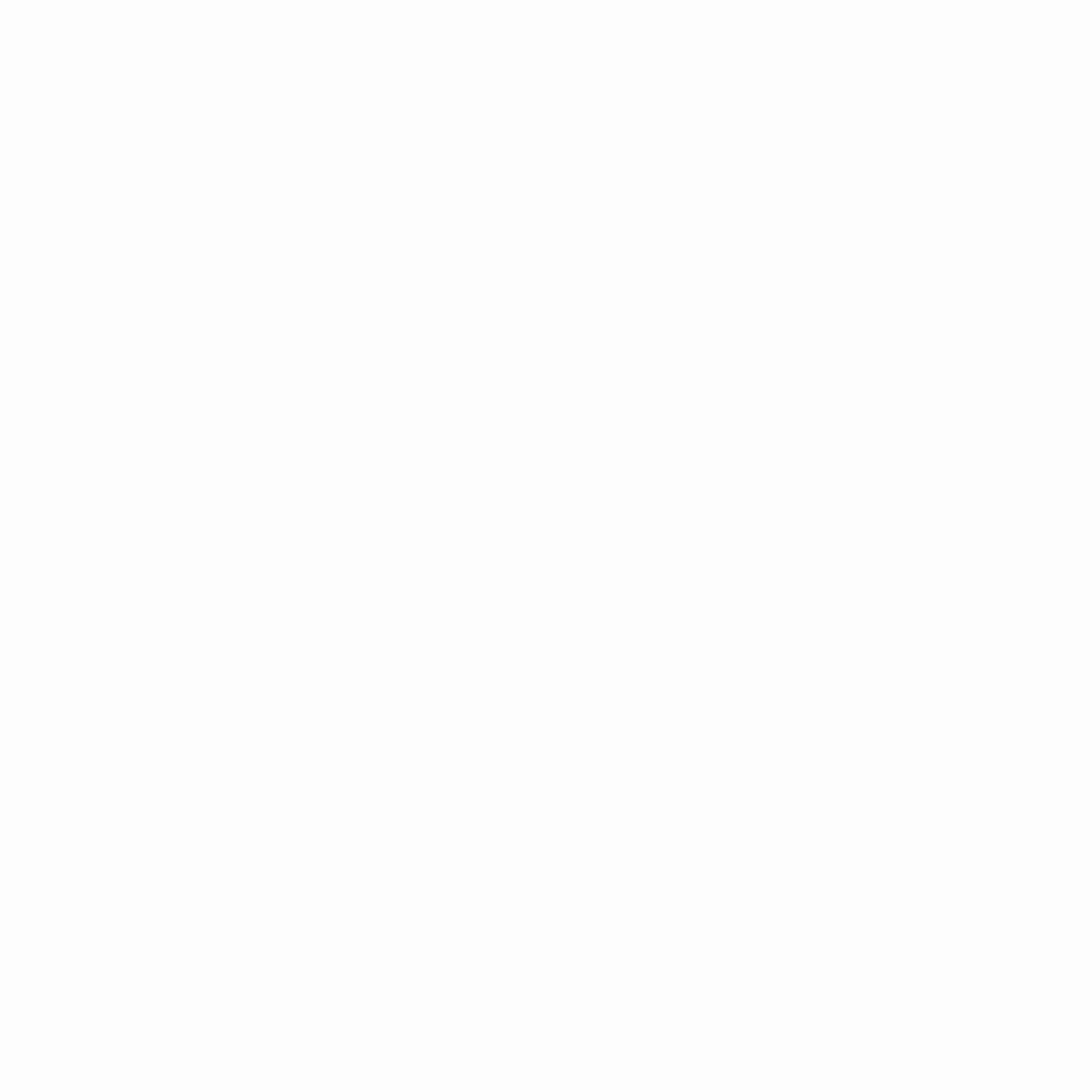Peu de films ont marqué leur genre avec une telle force qu’Il était une fois dans l’Ouest. Œuvre monumentale et crépusculaire, ce long-métrage s’ouvre sur une séquence d’une brutalité inouïe qui ancre immédiatement le spectateur dans un Ouest sauvage, dénué de tout romantisme. En choisissant de faire assassiner de sang-froid une famille entière, y compris son plus jeune enfant, par un tueur aux yeux bleus angéliques, le réalisateur ne se contente pas de choquer : il déconstruit un mythe. Ce film, conçu comme un adieu au genre qui l’a rendu célèbre, est une fresque opératique sur la fin d’une époque, où la vengeance personnelle croise la marche implacable d’un capitalisme naissant, symbolisé par l’avancée du chemin de fer.
La scène choc : l’impact de Frank sur le western
Un meurtre qui brise les codes du genre
La séquence d’ouverture est une masterclass de tension. Après un long massacre, le tueur, Frank, se retrouve face au dernier survivant, un jeune garçon. Le dialogue est bref, glacial. “Et Frank ?”, demande le père mourant. C’est alors que le chef des bandits s’avance, révélant un visage que le public associait jusqu’alors à l’intégrité et à l’héroïsme. Le choc est total. En un seul plan, le film anéantit des décennies de conventions hollywoodiennes. Le meurtre d’un enfant, tabou absolu, est ici montré sans fard, non pas comme une nécessité narrative, mais comme la signature d’un mal absolu, froid et calculateur. Cette scène n’est pas gratuite ; elle est fondatrice. Elle établit la noirceur du personnage de Frank et le ton désenchanté de tout le film.
La redéfinition du méchant de western
Jusqu’alors, les antagonistes du western étaient souvent des bandits rustres ou des propriétaires terriens avides, mais ils opéraient dans un cadre moral, même perverti. Frank est différent. Il n’est pas un hors-la-loi du vieil Ouest ; il est un homme d’affaires de la nouvelle ère, un prédateur dont la violence est un outil au service du profit. Il représente la corruption qui accompagne le “progrès”. La cruauté de son premier acte le place au-delà de la rédemption et fait de lui une figure bien plus terrifiante que ses prédécesseurs. Le spectateur ne peut ressentir pour lui aucune empathie, seulement de la fascination et de la révulsion.
Cette introduction brutale et inoubliable est la signature d’un cinéaste qui a passé sa carrière à remodeler les contours du western, le poussant dans ses derniers retranchements esthétiques et moraux.
Sergio Leone : un visionnaire du western spaghetti
L’architecte d’un nouveau langage cinématographique
Avant ce film, le réalisateur italien avait déjà dynamité le genre avec sa célèbre “Trilogie du Dollar”. Il y avait imposé un style unique, reconnaissable entre tous. Son approche se caractérisait par :
- Des cadrages extrêmes, passant de plans très larges écrasant les personnages dans des paysages désertiques à des très gros plans sur des yeux plissés par le soleil.
- Un rythme étiré, où de longs silences contemplatifs précèdent des explosions de violence fulgurantes.
- Une direction artistique qui montrait un Ouest sale et poussiéreux, loin de l’imagerie propre et colorée des productions américaines.
La musique comme personnage principal
La collaboration du cinéaste avec son compositeur attitré est l’une des plus fructueuses de l’histoire du cinéma. Dans Il était une fois dans l’Ouest, la musique n’accompagne pas l’action : elle la précède, la commente et parfois même la remplace. Chaque personnage principal se voit attribuer un leitmotiv musical qui le définit entièrement. Le thème lancinant de l’harmonica, la mélodie ample et lyrique de Jill ou le motif inquiétant de Frank sont des éléments narratifs à part entière. Le réalisateur composait ses scènes comme un opéra, faisant souvent jouer la musique sur le plateau pour guider le jeu de ses acteurs.
Une relecture critique du mythe américain
En tant qu’Européen, le metteur en scène portait un regard extérieur et désacralisé sur la conquête de l’Ouest. Il n’y voyait pas une épopée glorieuse, mais une histoire violente fondée sur la cupidité et le sang. Ses films sont peuplés de personnages cyniques et amoraux, motivés non pas par l’honneur, mais par l’argent ou la survie. Il a déconstruit le mythe du héros américain pour en montrer les facettes les plus sombres, une vision qui a profondément influencé le cinéma mondial.
Pour incarner le mal absolu dans cette fresque opératique, le réalisateur a fait un choix de casting qui allait à l’encontre de toutes les attentes, une décision aussi audacieuse que sa mise en scène.
Henry Fonda : transformation et choix audacieux
Le visage de l’Amérique vertueuse
Pendant plus de trente ans, l’acteur américain a incarné l’intégrité, la droiture et la conscience morale de l’Amérique. De Tom Joad dans Les Raisins de la colère au juré numéro 8 dans 12 hommes en colère, en passant par ses rôles de présidents et de shérifs, son visage était synonyme de justice et de bonté. Le public avait appris à lui faire confiance. Son regard bleu clair était perçu comme un gage d’honnêteté. C’est précisément cette image iconique que le réalisateur a voulu détruire.
Un casting à contre-emploi historique
Le cinéaste voulait absolument cet acteur pour le rôle de Frank. Il a dû longuement insister pour le convaincre d’accepter ce qui serait son premier et unique rôle de méchant. La légende raconte que pour se préparer, l’acteur s’était présenté sur le tournage avec une barbe et des lentilles de contact marron pour masquer son identité. Le réalisateur lui aurait alors ordonné de tout enlever, déclarant : “Je veux que le public voie tes yeux bleus innocents juste avant que tu ne massacres cette famille”. Le choc provoqué par ce contre-emploi était un élément central du dispositif. Le mal était d’autant plus terrifiant qu’il portait le masque de la vertu.
Face à ce monstre au visage d’ange se dresse une figure tout aussi mémorable, un homme sans nom dont l’unique moyen d’expression est une mélodie obsédante.
L’homme à l’harmonica : un symbole de vengeance
L’ange exterminateur silencieux
Dès sa première apparition, le personnage connu sous le nom d’Harmonica s’impose comme une figure quasi mythologique. Il est laconique, presque muet, et ses motivations restent obscures pendant une grande partie du film. Il n’est pas un héros traditionnel ; il est une force vengeresse, un fantôme revenu du passé pour réclamer son dû. Son silence et son économie de mouvements contrastent avec la violence de ses actes. Il est l’incarnation d’une justice immanente, un destin en marche qui ne peut être arrêté.
Le flashback comme clé de voûte émotionnelle
Le leitmotiv de l’harmonica, strident et dissonant, hante le film. Ce n’est que lors du duel final que sa signification est révélée dans un flashback d’une cruauté insoutenable. On y découvre le traumatisme originel du personnage : enfant, il a été forcé par Frank de porter son propre frère sur ses épaules, un harmonica dans la bouche, jusqu’à l’épuisement et la mort de ce dernier. Cette révélation change la nature du film, le transformant d’un simple récit de western en une tragédie grecque. La vengeance d’Harmonica n’est pas une question d’argent ou de territoire, mais la réparation d’une blessure intime et indicible.
Ce drame personnel, aussi puissant soit-il, se déroule dans un contexte bien plus large : celui d’un monde en pleine mutation, où les anciennes légendes doivent laisser place à une nouvelle ère.
La transition du vieil Ouest vers l’ère industrielle
Le chemin de fer, moteur du changement
Le véritable protagoniste du film n’est peut-être aucun des personnages, mais le chemin de fer lui-même. Sa construction progressive à travers le paysage est le fil rouge de l’intrigue. Il est le symbole ambivalent du progrès : d’un côté, il promet la civilisation, le commerce et la création d’une nouvelle société ; de l’autre, il est la source d’une cupidité sans limites qui pousse des hommes comme le magnat Morton et son homme de main, Frank, à tuer pour s’approprier les terres. Le sifflet du train remplace peu à peu le son des colts, annonçant la fin d’une époque.
Le crépuscule des mythes
Le film met en scène la disparition des figures archétypales du western. Le bandit au grand cœur, Cheyenne, et le vengeur solitaire, Harmonica, sont des dinosaures, des reliques d’un Ouest qui n’existe déjà plus. Leur code de l’honneur et leur maîtrise des armes deviennent obsolètes face à la logique froide de l’argent et des contrats. Leur départ à la fin du film, l’un vers la mort, l’autre vers l’inconnu, symbolise la fin de l’Ouest sauvage. Ils laissent derrière eux un monde qui n’a plus besoin d’eux.
L’avènement d’une nouvelle Amérique
Celle qui hérite de ce nouveau monde est Jill McBain. Après avoir tout perdu, elle ne cherche pas la vengeance mais la reconstruction. Elle incarne la résilience et l’avenir. En décidant de rester et de bâtir une ville autour de la nouvelle gare, elle devient la matriarche d’une Amérique en devenir, une société fondée non plus sur la violence des armes, mais sur le commerce et la communauté. Sa dernière scène, où elle apporte de l’eau aux ouvriers du chemin de fer, est un symbole puissant de la naissance de la civilisation.
Cette chronique poignante et désenchantée de la fin d’un mythe a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma, assurant au film une postérité qui dépasse de loin le cadre du western.
L’héritage durable d'”Il était une fois dans l’Ouest”
Une influence formelle et thématique
Par sa radicalité esthétique et sa profondeur thématique, le film a influencé des générations de cinéastes. Son utilisation de la durée, son sens du cadre, sa narration opératique et sa déconstruction des mythes ont été cités comme une référence majeure par de nombreux réalisateurs, de Quentin Tarantino à Martin Scorsese. Il a prouvé que le western pouvait être un véhicule pour une réflexion complexe sur l’histoire, la violence et la nature humaine. Il a élevé le “western spaghetti” au rang d’art majeur.
Une reconnaissance critique tardive mais unanime
À sa sortie, le film a connu des destins contrastés. Si son succès fut phénoménal en Europe, notamment en France, sa réception initiale aux États-Unis fut plus mitigée, en partie à cause d’une version amputée de près de vingt minutes par les studios. Avec le temps, la critique américaine l’a réévalué pour le considérer aujourd’hui comme un chef-d’œuvre absolu et l’un des plus grands films jamais réalisés.
Réception du film
| Région | Accueil initial | Statut actuel |
|---|---|---|
| Europe (spéc. France) | Succès commercial et critique immédiat | Film culte, classique intemporel |
| États-Unis | Accueil mitigé, échec commercial relatif | Chef-d’œuvre unanimement reconnu |
Le film est bien plus qu’un simple western. C’est une élégie funèbre, une méditation sur le temps qui passe et la fin des légendes. En signant cet adieu majestueux au genre, son réalisateur a paradoxalement créé l’œuvre qui en représente le sommet indépassable.
À travers une scène d’ouverture traumatisante, le film établit un univers sans pitié, magnifié par la vision d’un réalisateur au sommet de son art. Le choix audacieux de confier le rôle du mal absolu à une icône de la vertu a marqué les esprits, tout comme la quête de vengeance portée par un personnage énigmatique et sa mélodie inoubliable. En relatant la transition brutale entre l’Ouest mythique des pistoleros et l’ère industrielle du chemin de fer, cette œuvre s’est imposée comme un chef-d’œuvre crépusculaire dont l’héritage cinématographique reste aujourd’hui encore immense.