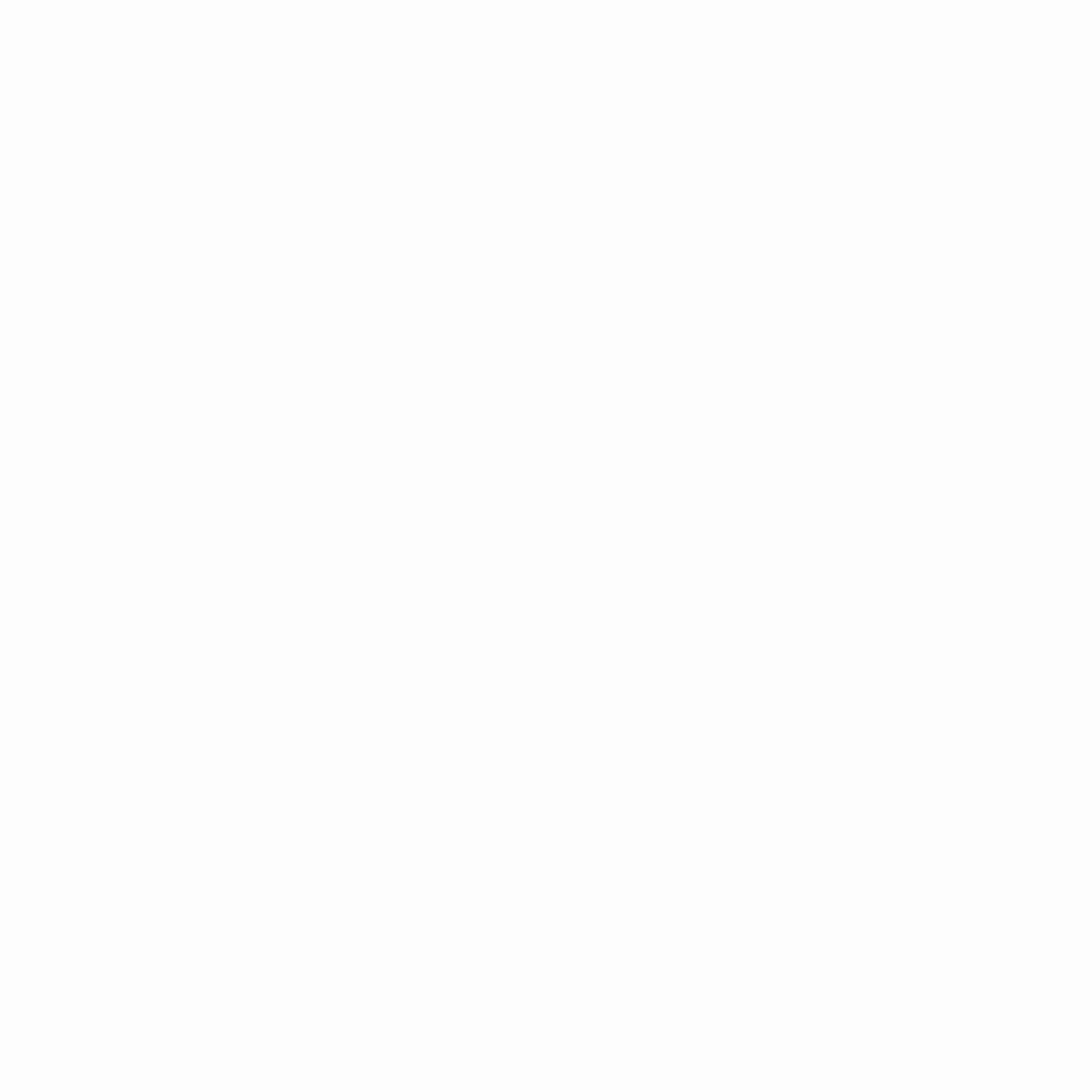À mi-chemin entre Minority Report et Hunger Games, la nouvelle superproduction française signée Cédric Jimenez nous en met plein les yeux. Mais à force de vouloir impressionner, elle perd ce qui aurait pu faire sa force : un vrai propos.
Un Paris du futur, bien rangé en trois zones
Une ville divisée… comme ses ambitions
Adapté d’un roman de Laurent Gaudé, Chien 51 prend ses quartiers dans un Paris futuriste, où la violence est partout, les murs bien hauts et les classes sociales compartimentées comme des wagons de métro à l’heure de pointe.
Zone 3 : les laissés-pour-compte. Camés, miséreux, marginaux, et flics en fin de course.
Zone 2 : les privilégiés, dorés sur tranche, surveillés par une police chic et high-tech.
Zone 1 : les puissants. Les vrais. Ceux qui décident.
Dès le départ, tout est en place. L’ambiance est sombre. L’univers, ultra-militarisé. Et la mise en scène ? Soignée jusqu’au dernier pixel.
L’enquête commence, mais la critique s’arrête
Une intrigue bien ficelée… mais prévisible
Zem Brecht (Gilles Lellouche), vieux flic déglingué de la Zone 3, est appelé à faire équipe avec Salia (Adèle Exarchopoulos), brillante enquêtrice de la Zone 2.
Leur mission ? Découvrir qui a tué le créateur d’ALMA, une IA toute-puissante censée protéger la ville… mais qui semble peu à peu échapper à tout contrôle.
Sur leur route : des drones tueurs, des bastons nerveuses, des embuscades, des menaces, et une révolution qui gronde.
À la tête des “terroristes” rebelles, un certain John Mafram, interprété par un Louis Garrel mystérieux à souhait. Trop, peut-être.
Mais voilà : aussi spectaculaire que soit l’enquête, on voit venir chaque rebondissement à des kilomètres. Même le “twist” final a l’air d’avoir été copié-collé d’un vieux fichier oublié dans un dossier “idées en attente”.
Du grand spectacle ? Oui. Du fond ? Non.
Jimenez maîtrise la forme… et c’est déjà pas mal
Il faut le dire : en matière de mise en scène, Cédric Jimenez n’a rien à envier à Hollywood.
La scène d’ouverture claque comme une porte qu’on aurait trop longtemps retenue. Les courses-poursuites en voiture sont millimétrées, les drones font froid dans le dos, les combats sont secs, précis, brutaux.
Un duel homme/drone dans une ruelle, une traversée nocturne de la Seine sous les balles… du très haut niveau.
On sent le plaisir qu’a le réalisateur à tourner ce genre de séquences. Il y va à fond. Il muscle son cinéma. Il modernise l’action à la française. Et sur ce point-là, Chien 51 coche toutes les cases.
Une esthétique puissante, un Paris dystopique crédible
La photographie est glacée, métallique. Les décors, futuristes mais crédibles. On y croit.
Paris devient une cage, une arène, une ville-forteresse.
Le moindre passage d’une zone à l’autre est un checkpoint, une tension.
C’est beau, c’est sombre, c’est inquiétant.
Mais au milieu de cette perfection visuelle, quelque chose cloche.
Le syndrome Avatar : grand spectacle, petit message
Une dystopie qui ne mord pas
Chien 51 aurait pu être un film politique.
Son univers s’y prête : dérives sécuritaires, surveillance de masse, inégalités sociales criantes.
Mais à force de tout effleurer sans jamais approfondir, le film se désarme lui-même.
Il commence avec des promesses : une critique de la violence d’État, un regard sur la privatisation de la sécurité, un questionnement sur l’IA.
Mais il finit par désigner un coupable trop facile : la machine elle-même.
L’IA, bouc émissaire de service
En rendant ALMA incontrôlable, Chien 51 détourne le débat.
L’État ? Victime de son propre outil.
Le ministre (Romain Duris) ? Un pantin désarmé.
Les révoltés ? Des silhouettes inquiétantes.
En somme : plus personne n’est responsable. Ce n’est pas le système qui est en cause. C’est la machine.
Un choix scénaristique qui gomme tout discours social. Et transforme une dystopie en simple fable technophobe.
Des personnages à la peine
Des archétypes qui peinent à respirer
Gilles Lellouche fait le job. Il est solide, intense, cabossé.
Adèle Exarchopoulos est plus en retenue, plus froide, presque éthérée.
Leur duo fonctionne… en apparence. Mais leurs échanges manquent de chair. De lien. De vécu.
Louis Garrel, lui, incarne un chef rebelle charismatique. Trop charismatique. On sent la pose. Le rôle un peu trop écrit, un peu trop flou.
Personne ne sort vraiment du cadre. Chacun reste à sa place. Et c’est peut-être ça, le vrai problème : Chien 51 ne déborde jamais.
Une peur assumée du désordre ?
Une révolte qui fait peur… même au film
Autre curiosité du récit : la peur de la révolution.
Oui, la société que montre Chien 51 est injuste.
Oui, les personnages veulent en sortir.
Mais ceux qui prennent les armes sont montrés comme des figures presque monstrueuses. Dérangeantes. Difficiles à suivre.
Le film semble pris dans une contradiction : il critique l’ordre établi… mais redoute ce qui pourrait le remplacer.
Il rêve d’émancipation… mais craint les émeutes.
Résultat : il reste au milieu du gué. Et ne prend jamais vraiment parti.
On sort du film avec quoi ?
Des images fortes, mais des idées floues
Chien 51, c’est un peu comme une boîte de chocolats de luxe. Le design est parfait. La texture, soyeuse. Le goût ? Agréable. Mais il manque quelque chose. Une saveur, une surprise, un vrai choc.
Le film impressionne. C’est indéniable.
Mais on aurait aimé qu’il dérange aussi.
Qu’il questionne. Qu’il provoque.
Au lieu de ça, il rassure. Il rentre dans les cases. Il fait “propre”.
Alors, faut-il aller voir Chien 51 ?
La réponse est oui… si vous aimez les films d’action français qui osent le grand format.
Oui, si vous voulez voir Paris transformée en dystopie crédible.
Oui, si vous êtes curieux de voir ce que notre cinéma peut produire avec 40 millions d’euros et un casting XXL.
Mais si vous cherchez une fable politique forte, un message clair, ou un scénario audacieux… vous resterez sur votre faim.