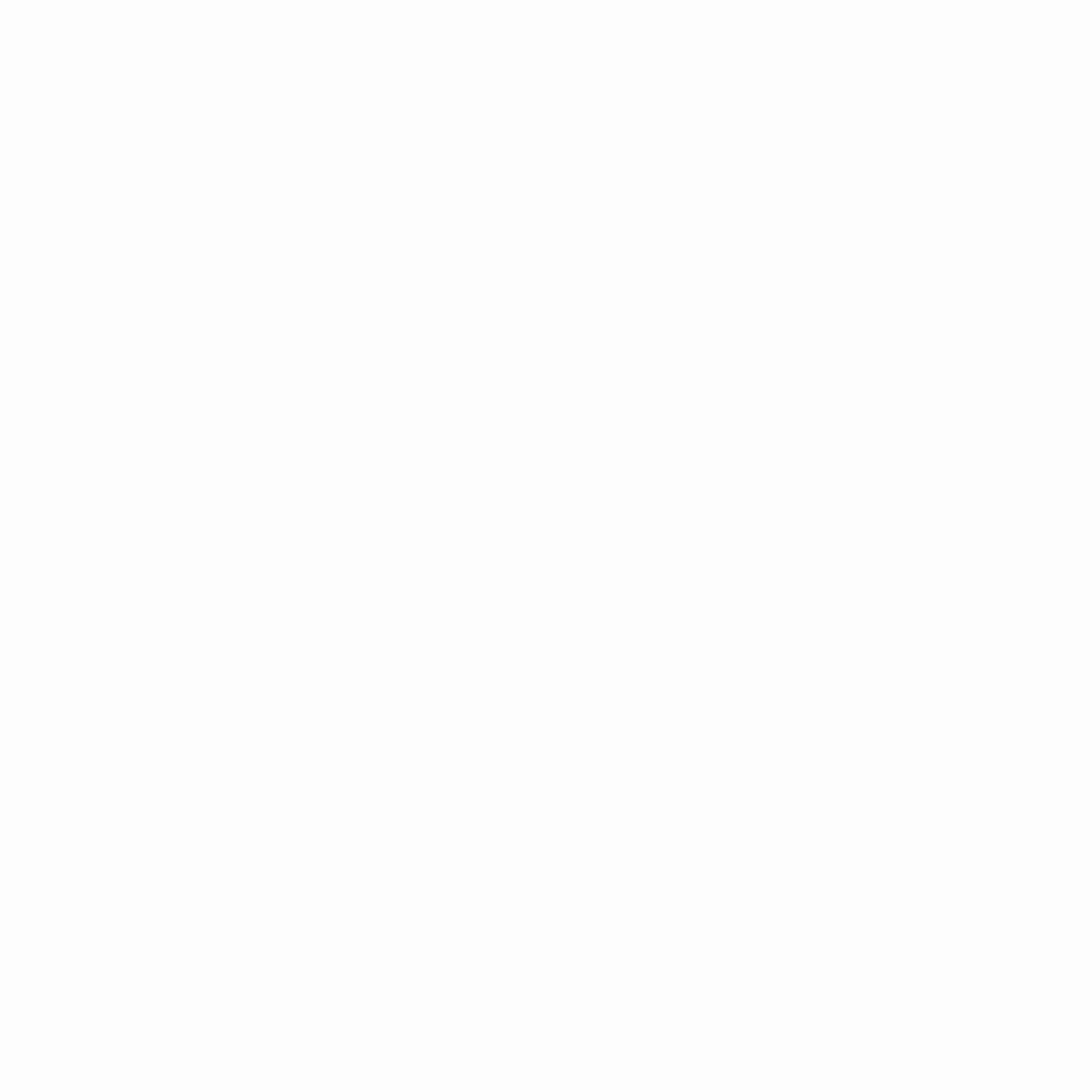Il y a des films qui te prennent par le col dès la première minute et te traînent dans leur sillage avec un sourire un peu carnassier. Le remake de The Running Man signé Edgar Wright, adapté du roman de Stephen King, fait exactement ça : ça démarre sur les chapeaux de roue, ça garde le pied au plancher, et ça te colle une montée d’adrénaline si constante que tu finis par accepter une règle simple du jeu : ici, la vraisemblance n’est pas un tribunal, c’est une énergie. Et franchement, c’est une qualité, pas un défaut.
Oui, le film va vite. Oui, il te laisse parfois à peine le temps de reprendre ton souffle. Mais c’est aussi ce qui le rend terriblement efficace : Wright transforme l’histoire en expérience physique, presque euphorisante, qui épouse parfaitement le sujet. Un jeu télé où des citoyens sont traqués en direct, c’est précisément le royaume du rythme, de la coupe nerveuse, de la manipulation, du spectacle permanent. Le film ne te raconte pas seulement ça : il te le fait ressentir.
Une dystopie pas “loin” : le décor est crade, crédible, et ça pique là où il faut
Ce qui frappe d’abord, c’est le monde dans lequel on débarque. Wright s’éloigne de l’esthétique “plateau TV” clinquante pour quelque chose de plus moderne, mais surtout plus sale moralement : une société où l’abondance est un décor en carton, et où la misère, elle, est filmée en plein jour.
On ne te sert pas une dystopie abstraite. On te sert un quotidien qui ressemble un peu trop à une version déformée de nos angoisses : soins inaccessibles, jobs précaires, attente interminable, menace de la rue, et cette sensation que tout est truqué au bénéfice de ceux qui possèdent déjà tout. Le film assume son ADN social sans bégayer, et ça lui donne une colonne vertébrale. Quand Ben évoque ce genre de “petits souvenirs lumineux” qui, dans ce monde, deviennent des luxes, tu comprends immédiatement l’ampleur de l’étouffement.
Ben Richards : un anti-héros rugueux, moderne, et parfaitement à sa place
Le film repose sur Ben Richards (incarné par Glen Powell) et, bonne surprise, il n’essaie pas d’en faire un héros lisse et vendable dès la première bobine. Ben est à vif. Il a cette colère qui déborde parce que l’injustice est partout, tout le temps. Il n’a pas les codes pour “faire le dos rond”, et évidemment, dans un système construit pour te casser, ça ne pardonne pas.
C’est là que Powell est très juste : il apporte une énergie nerveuse, un mélange d’urgence et de rage contenue qui colle à l’époque. Ce n’est pas le charisme “monument” d’un héros invulnérable. C’est mieux pour ce film-là : un corps et un visage qui semblent réellement pris au piège, qui encaissent, improvisent, se mettent en danger parce qu’il n’y a plus d’issue propre.
Le show : une machine à broyer (et une satire qui mord sans faire la leçon)
Le cœur du film, c’est évidemment The Running Man, l’émission présentée par un showman au sourire impeccable (et au cynisme parfaitement huilé). Le concept est simple et ignoble : des “coureurs” doivent survivre en se cachant, pendant que des chasseurs les traquent. Drones, écrans, narratif imposé, et participation du public… jusque dans la délation. Oui, ça fait froid dans le dos. Oui, ça ressemble un peu trop à des réflexes déjà bien installés.
Ce qui fonctionne très bien, c’est la manière dont le film montre la fabrication du monstre médiatique. Ben ne devient pas seulement une cible physique : il devient une histoire qu’on tord, un symbole qu’on salit, un “parasite” qu’on désigne à la foule pour qu’elle se sente vertueuse en hurlant avec le groupe. L’émission n’est pas juste du divertissement : c’est une pédagogie de la cruauté, emballée dans du glamour.
Et là, Wright est malin : il ne te fait pas un long discours sur “les médias”, il te laisse regarder la mécanique se déployer, et tu comprends tout seul à quel point elle est efficace.
Edgar Wright en mode virtuose : montage, musique, chorégraphie, plaisir pur
Wright, on le sait, c’est un obsessionnel du rythme et du détail. Ici, il est dans son terrain de jeu idéal : poursuites, violence stylisée, montage au cordeau, humour qui surgit sans casser la tension. Le film enchaîne les séquences comme des coups de cymbales : ça frappe, ça relance, ça ne te lâche pas.
Et le plus important : c’est nerveux mais lisible. Frénétique, mais toujours orienté. Tu sens qu’il s’amuse avec la forme, mais qu’il ne fait jamais “joli pour être joli”. Dans un film qui parle de spectacle permanent, la mise en scène devient le langage du propos : séduisante, addictive, et légèrement inquiétante quand tu réalises à quel point tu te laisses embarquer.
Les seconds rôles : croqués à la serpe, mais pile dans le ton
Le film va vite, donc oui, certains personnages secondaires apparaissent, marquent, puis s’effacent. Mais c’est cohérent avec l’idée centrale : dans un monde transformé en show, les gens deviennent des segments, des fonctions dans une narration. C’est brutal, et c’est justement ce que le film raconte.
Et quand un acteur comme Michael Cera débarque avec son décalage naturel, ça apporte une couleur très contemporaine : une forme de nervosité drôle, presque gênante, qui colle bien à cette dystopie où tout le monde essaie de survivre entre deux caméras.
Une satire instinctive (plutôt qu’“intellectuelle”) — et c’est pour ça qu’elle marche
On pourrait reprocher au film de ne pas s’arrêter pour “creuser” plus longuement sa critique. Mais ce serait oublier une chose : la satire est dans la vitesse. Le film t’embarque comme il embarque le public de l’émission. Tu veux voir la suite. Tu veux savoir s’il s’en sort. Tu es pris dans la mécanique. Et pendant ce temps-là, le monde autour continue de se décomposer.
C’est précisément le propos : montrer à quel point le spectacle peut avaler tout le reste. La critique n’est pas un panneau explicatif. C’est une sensation qui te colle à la peau.
Glen Powell : pas une icône “intouchable”, mais un moteur parfait pour cette histoire
Certains regretteront peut-être l’absence d’un héros “mythique” à l’ancienne. Moi, je trouve que le film gagne à être porté par une présence plus humaine, plus exposée, moins invincible. Parce que l’histoire parle d’exploitation, de corps consommés, de souffrance transformée en contenu. Dans ce cadre, avoir un héros “au-dessus” aurait presque affaibli l’impact.
Powell tient le film par l’énergie, par le nerf, par ce côté “sur le fil” permanent. C’est une performance motrice, pas un numéro de statue. Et pour The Running Man, c’est exactement ce qu’il faut.
Ce que le film réussit vraiment : te divertir… et te laisser un goût de métal en bouche
Le plaisir est réel : c’est tendu, c’est drôle quand il faut, c’est virtuose, c’est une cavale ultra efficace. Mais le film a une petite cruauté supplémentaire : il te fait sentir que toi aussi, spectateur, tu peux être happé par ce qu’il dénonce.
Et c’est là que la critique devient franchement bonne : Wright ne moralise pas, il met le doigt là où ça fait mal. Il te donne du spectacle, puis il te glisse, presque en douce, cette question qui reste : est-ce qu’on regarde la critique… ou est-ce qu’on est déjà en train d’en faire partie ?
Un film qui amuse, qui cogne, et qui mord. Pas parfait par choix, mais parfaitement cohérent.