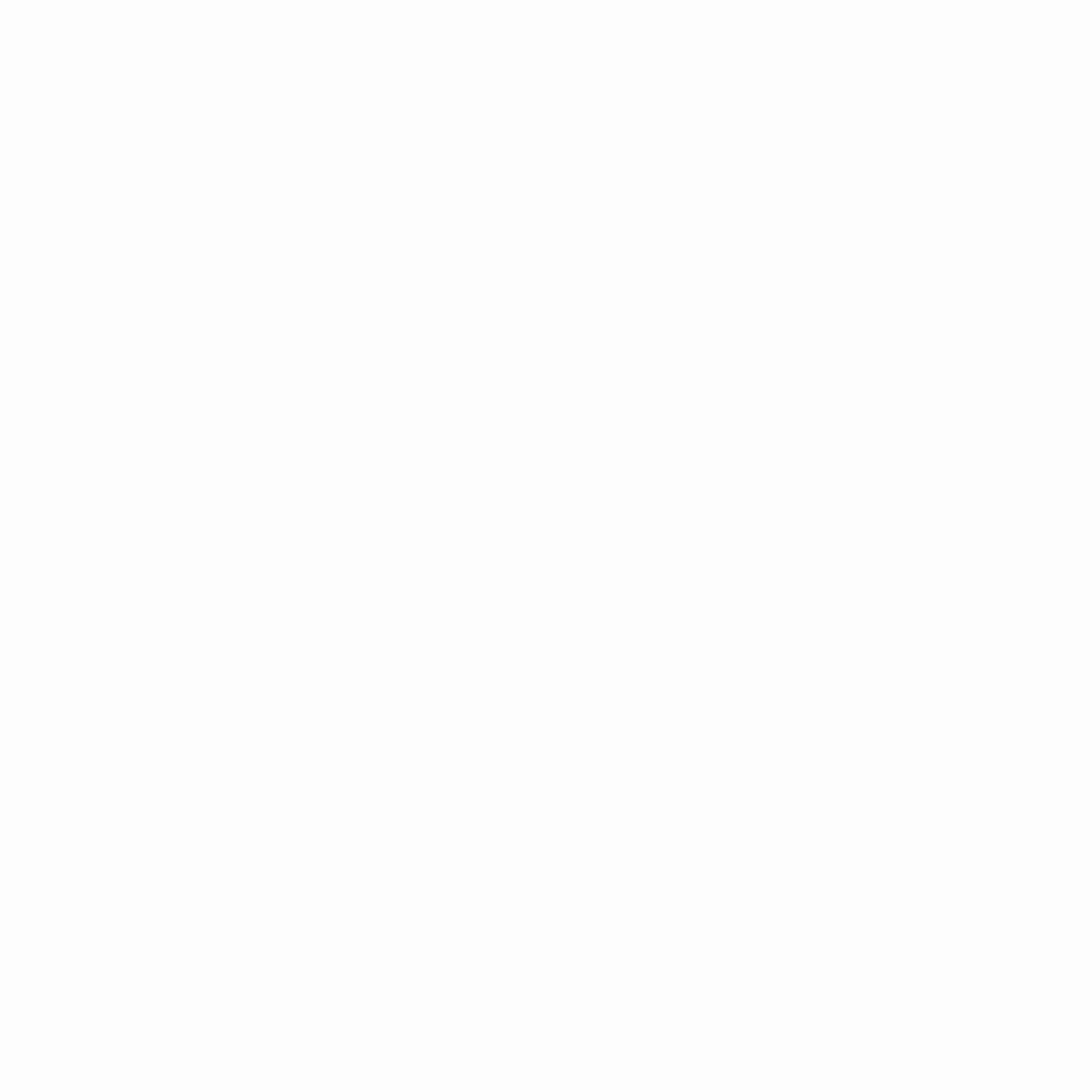Avec Predator : Badlands, Dan Trachtenberg tente quelque chose de rare dans une franchise qui semblait condamnée à s’auto-répéter : déplacer le regard. Ce septième volet, qui aurait pu n’être qu’un avatar de plus dans une saga essoufflée, surprend par son envie de dynamiter ses propres codes et d’explorer un territoire plus aventureux, parfois bancal, mais animé d’une vraie sincérité.
Ce qui frappe d’abord, c’est la structure éclatée du film, construite en segments successifs qui donnent presque l’impression d’un récit en chapitres. L’ouverture, centrée sur un très jeune Predator face à un père implacable, est l’une des plus belles idées du film : une sorte de rite initiatique extraterrestre porté par des effets spéciaux étonnamment soignés, presque trop pour une licence qui a souvent été malmenée visuellement.
Puis le film bascule dans une direction inattendue : un buddy movie improbable entre un Predator revanchard et Thia, une androïde lumineuse et spontanée, interprétée avec une fraîcheur magnifique par Elle Fanning. C’est elle qui, paradoxalement, apporte au film sa part d’humanité. Le duo fonctionne, parfois malgré lui, et cette relation décalée offre au récit un supplément d’âme qui manquait cruellement aux derniers épisodes.
Sur le plan narratif, Badlands reste un film de pure série B, rythmé, musclé, souvent bourrin, mais porté par une énergie presque enfantine, comme si un fan absolu des comics Dark Horse avait enfin pu mettre en scène ses fantasmes d’adolescent. Même lorsque l’on sent passer les limites du scénario – parfois trop littéral, parfois trop sage – impossible de nier l’enthousiasme qui traverse le film.
Cette générosité se double d’une envie assumée de sortir du sempiternel « remake du remake » : pour une fois, on tente de renouveler la formule. Le changement de point de vue, centré sur le monstre, fonctionne bien. On apprécie aussi la volonté de dépasser l’iconographie habituelle pour titiller la mythologie.
Mais cette audace n’efface pas les faiblesses évidentes :
– un montage trop brouillon dans les scènes d’action,
– une lisibilité parfois sacrifiée,
– un caractère éphémère qui rend l’ensemble moins mémorable qu’il aurait pu l’être.
On sent un film attachant mais limité, qui oscille constamment entre l’inspiration et la série B trop lisse. Certains y verront un divertissement entraînant, un « pop-corn movie » sans culpabilité. D’autres y liront l’aveu d’une saga devenue produit de consommation rapide, loin de la brutalité originelle imaginée par McTiernan. La vérité se situe sans doute entre les deux.
En résumé
Predator : Badlands est une tentative de réinvention qui ne réussit pas tout, mais qui a le mérite d’oser. Entre un duo Predator/androïde étonnamment touchant, des idées visuelles fortes et une vraie générosité, le film trouve un souffle que la franchise avait perdu. Dommage que ses limites formelles et son manque d’impact durable le retiennent d’atteindre un niveau supérieur.
Un film imparfait, parfois brouillon, mais vivant — et pour un Predator, c’est déjà beaucoup.